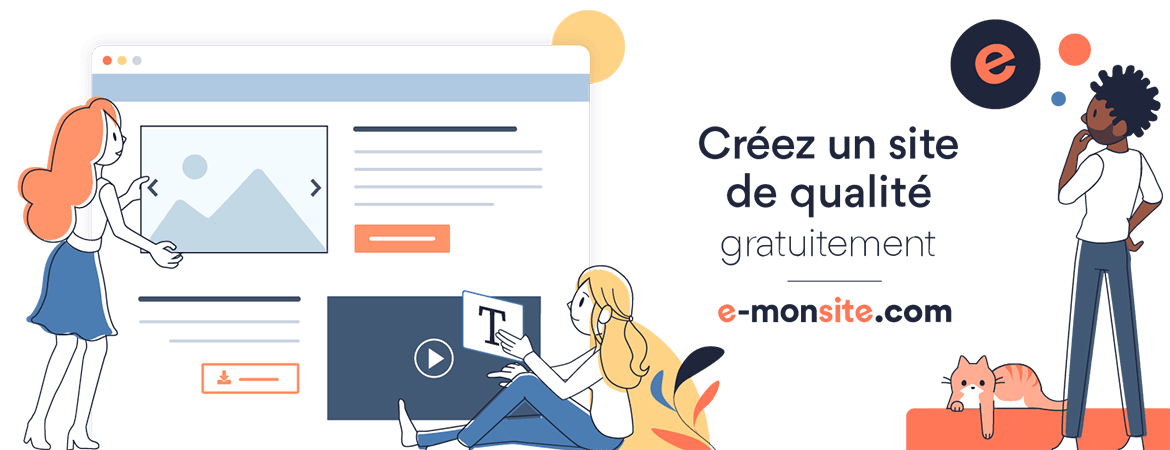En télétravail ou au chômage partiel, avec les enfants à la maison, privé de visites et de sorties… Votre relation au temps a changé depuis le début du confinement. Certains en profitent pour s’adonner à de saines activités : un peu de sport pour s’entretenir, quelques webinaires pour se perfectionner, de la lecture pour se cultiver, de la cuisine pour se distraire… Pourquoi ne pas prendre aussi quelques instants pour votre épargne et procéder à un premier bilan patrimonial ?
Bien sûr, vous pouvez consulter votre conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE, bien que confiné, il a la chance de pouvoir exercer son métier en télétravail également.
Si vous hésitez à consulter un professionnel, voici la marche à suivre, version très éducorée mais déjà efficace, de celle que nous appliquons à nos clients :
1. Dressez la liste de vos placements
Commencez par faire le point sur l’existant. Que possédez-vous précisément et pour quels montants ? Si la question peut paraître triviale, vous réaliserez rapidement que ce n’est pas le cas. Faites le tour de vos livrets, y compris ceux sur lesquels stagnent quelques dizaines ou centaines d’euros (vous pouvez inclure les comptes courants dormants à ce stade).
Recensez ensuite vos diverses enveloppes : assurances vie, plan d'épargne en actions (PEA), compte-titres, contrats de capitalisation… Sans omettre l’épargne retraite, si facile à oublier : plan d’épargne retraite populaire (Perp) et/ou Madelin. Enfin, ne faites pas l’impasse sur l’épargne salariale détenue dans les différentes entreprises fréquentées (plan d’épargne entreprise ou PEE, Plan d’épargne retraite collectif (Perco) et Article 83, pour citer les plus courants).
2. Déterminez votre budget
Reprenez deux années de relevés de compte bancaire et faites le point des revenus qui entrent et des dépenses qui sortes.
Un tableau excel vous aidera ; certains comptes bancaires peuvent d'ailleurs être extraits pour vous faciliter la tâche, certaines applications également. Il est important de cataloguer vos postes de dépenses de façon assez fine : logement, santé, nourriture, entretien-hygiène, automobilie, impôts, vacances, culture-loisirs, épargne, scolarité des enfants,... et de vérifier l'équilibre du budget, les sources de dépenses qui peuvent être diminuées voire annulées...
3. Limitez les montants placés sur des livrets
Commencez par faire le tri dans vos livrets, comptes et autres produits d’épargne de précaution. Le constat est sans appel : vous en possédez sûrement trop ! A fermer : les vieux comptes et livrets dormants. Au pire, ils vous coûtent tous les ans, au mieux, ils ne servent à rien.
Mettez votre temps à profit pour contacter les établissements bancaires concernés et demandez à vider les comptes puis à les fermer.
A garder : votre livret A et votre livret de développement durable et solidaire (LDDS). Vérifiez néanmoins l’ampleur des sommes déposées. L’épargne de précaution ne doit pas dépasser 3 à 4 mois de revenus. C’est un ordre de grandeur, vous pouvez choisir de conserver un peu plus bien sûr, mais au-delà de six mois c’est résolument excessif ! Le surplus devrait être placé dans des enveloppes de long terme.
Que faire de mon vieux PEL ?
Les PEL de plus de douze ans sont soumis à la “flat tax” de 30% (un taux unique de 30% qui taxe les revenus du capital, donc en majorité les placements), mais ils offrent, selon la génération, une rémunération attrayante. Par exemple, un plan ouvert en 1995 avec un taux facial (qui permet de calculer les intérêts dus) de 3,84%, rapporte 2,69% net de flat tax.
Ainsi, entre le brut et le net, la performance d'un PEL ouvert en 1995 reste plus attractif qu'un fonds euro sans sa flat tax. Voilà qui incite à conserver le produit. Gardez toutefois en tête qu’un PEL est moins souple qu’un livret : au moindre retrait, le plan sera fermé.
4. Triez vos assurances vie
Il peut être très pertinent de détenir plusieurs contrats, si les raisons sont valables. Par exemple, vous avez ouvert une assurance vie pour chacun de vos neveux et nièces afin de leur transmettre de l’argent à votre décès. C’est nettement moins pertinent si vous avez souscrit dans le seul but de faire plaisir à votre conseiller bancaire.
Etudiez en outre la qualité de vos contrats, ce qui est à l'intérieur de celui-ci. Il s'agit de regarder le nombre de fonds élligibles au contrat, les performances passées de ces fonds, leurs frais courant ou encore leur notation sur Quantalys. Cela va permettre de constater de la qualité du fonds en euros par exemple.
Prenez ensuite les mesures qui s’imposent ! Je clôture progressivement : les vieilles enveloppes non dotées d’avantages spécifiques (taux garantis) en vérifiant bien que vous ne perdez pas d’atouts fiscaux. Si vous êtes un peu perdu, vous pouvez toujours nous consulter.
Ensuite, comment procéder ? Des rachats progressifs peuvent être réalisés dès lors que le contrat a plus de huit ans. Il suffit de respecter les limites d’abattement (4.600 euros pour un célibataire et 9.200 euros pour un couple) et de reverser ces sommes sur un contrat sans frais d’entrée.
Il convient de noter qu'en faisant appel à votre Conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE et en lui indiquant le code "ASP" qui signifie que vous avez lu cet article, vous bénéficierez de l'absence de droits d'entrée sur tous les contrats d'assurance-vie que nous commercialisons !
Et n’oubliez pas qu’un contrat en moins-value ne supporte pas l’impôt… Je garde : les produits de qualité bien sûr, mais aussi tous ceux qui bénéficient d’atouts fiscaux.
5. Mettez votre épargne salariale en ordre
Si vous avez quitté des entreprises où vous possédiez un PEE, vous êtes encore titulaire de ces plans. Dans ce cas de figure, vous pouvez les conserver mais les frais de tenue de compte sont alors à votre charge. Mieux vaut regrouper tous vos avoirs chez votre nouvel employeur, si c’est possible.
Autre option : retirer vos fonds, en particulier s’il s’agit de petites sommes que vous ne gérez pas activement. Le départ de l’entreprise étant un cas de déblocage exceptionnel (sans impôt), vous pouvez, avec un simple courrier auprès du teneur de compte, demander un virement sur votre compte courant (que vous pourrez réallouer ensuite – nous y viendrons).
Pour un Article 83, une option intéressante s’offre à vous : transférer votre épargne sur le nouveau plan d’épargne retraite (PER) via un plan d’épargne retraite populaire (Perp). Un double transfert à réaliser ce mois-ci unquement (compte tenu des délais de transfert), pour vous permettre de profiter de la sortie en capital du PER et du déblocage anticipé pour l’achat d’une résidence principale.
6. Adoptez les bonnes règles pour vos investissements boursiers
Le temps filant, il est fréquent de laisser végéter ses investissements. Résultat, votre Plan d'épargne en actions PEA ronronne voire, bien plus embêtant, il devient très risqué car il n’est plus correctement diversifié. Autre phénomène courant : vous avez délaissé le travail d’allocation au sein de votre assurance vie. Faute de savoir comment investir, vous avez opté pour un 100% fonds en euros. Ce n’est pas une fatalité !
Deux options s’offrent à vous pour développer votre patrimoine. Optez pour une gestion sous mandat. Si vous n’avez pas le temps, l’envie ou les capacités pour piloter votre épargne financière, recourez aux services de votre conseiller AVENIR & SERENITE PATRIMOINE, qui le fera pour vous, bien sûr en échange d’une commission. Pour que ça vaille le coup et porte ses fruits, faites preuve de rigueur. Pour cela, rien de tel que des versements réguliers.
Mieux vaut opter pour des versements programmés, même de faible montant. D’abord, vous augmenterez votre capital sans effort (les montants peuvent facilement être modifiés à la hausse ou à la baisse) et vous lisserez en plus vos points d’entrées sur les marchés financiers.
7. Valorisez votre épargne
Normalement, si vous avez suivi nos recommandations, vous avez dû récupérer – à droite et à gauche – quelques centaines ou milliers d’euros qui dormaient, soit sur des comptes oubliés, sur des livrets mal rémunérés ou sur des produits peu performants.
Valorisez cette épargne en l’investissant de manière efficiente, en fonction de votre objectif et de votre profil. Et si vous faites partie de ceux qui dépensent moins en période de confinement, pourquoi ne pas vous fixer un objectif sympathique : vous constituer une cagnotte avec cet argent, que vous placerez dans la perspective d’un projet qui vous tient à cœur (un beau voyage, l’achat d’une voiture…)
Une façon de créer du positif à partir de la situation actuelle !